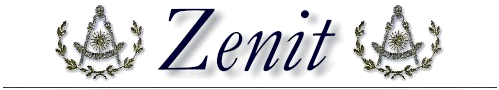
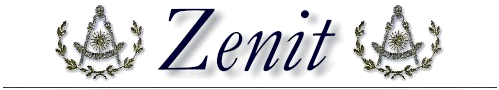
![]()

Maurizio Nicosia
La crise de l’Occident
et les devoirs de la Franc-maçonnerie
Traduction française par
Marie-Anne Peric
La chute du mur de Berlin avait suscité dans le monde l’espoir d’une période désormais à l’abri des conflits et des déchirures idéologiques. L’illusion a été brève: avec la chute du mur de Berlin, une multitude de nouveaux murs se sont à grand fracas abattus sur l’Occident et la planète entière. Il suffit de rappeler les conflits dans l’ancienne zone soviétique, en Afrique, en Inde, l’Islam. Il existe des signes inquiétants qui n’autorisent pas à limiter l’interprétation du phénomène à la profonde crise qui traverse l’ex galaxie soviétique et sa zone d’influence. Afrique du Sud, Moyen-Orient, révoltes noires en Amérique, les conflits abondent. En Europe resurgissent de préoccupantes remontées racistes et antisémites, et au moment où de nombreux gouvernements discutent du projet d’unité européenne, divers mouvements prédisent l’éclatement des états.
Le phénomène n’est pas simplement politique: il suffit pour s’en convaincre de prêter attention aux faits divers. Depuis plusieurs années aux Etats-Unis, des bandes s’affrontent, non pas pour des motifs politiques ou idéologiques, mais pour la maîtrise d’un terrain ou la couleur d’un maillot. Et en Europe, au nom du drapeau d’une équipe ou d’une commune, s’allume le feu de batailles analogues. Cette épidémie qui trouve dans la politique, la race ou la religion son véhicule, non son origine, s’étend désormais sur toute la planète. On pourrait multiplier les exemples: les raisons des affrontements, des conflits ou des éclatements sont aussi complexes que diverses, mais leur dynamique est la même.
A l’origine de l’épidémie, il y a l’extension en tache d’huile d’une vision du monde en noir et blanc, d’allure "manichéenne", éliminant tous détails et nuances, profondément et radicalement dualiste, antinomique et antithétique, se fondant sur la nécessité de transformer l’autre en antagoniste, en adversaire, en ennemi pour affirmer sa propre identité.
L’origine du phénomène réside dans le système de pensée, ou si l’on veut dans l’organisation de l’esprit, dans ces schémas que l’imaginaire forme à l’intérieur de la psyché de l’homme d’aujourd’hui, dans une région profonde dont il a lui-même très rarement conscience. L’expression passe ensuite par la médiation de la politique, de l’idéologie, par celle de la religion ou de la culture, ou tout simplement par celle d’une quelconque différence. C’est malheureusement ce système de pensée dualiste, fondé sur l’opposition à l’autre et l’affirmation de soi-même, entraînant, dans le domaine moral, la conviction dangereuse d’être non pas dans le juste, mais d’être le juste, qui a envahi aussi l’ordre maçonnique. Le cas Di Bernardo est éloquent.
Une fois admise la généralisation de ce phénomène épidémique qui transcende les structures culturelles pour s’enraciner dans l’organisation de l’esprit et de l’imaginaire qui l’alimente, une fois pris en compte ce fonctionnement par antithèses du système de pensée, reste à examiner la cause qui le diffuse, tant dans les sociétés de hautes technicité que dans les pays pauvres et peu alphabétisés.
C’est un système de pensée qui présente toutes les caractéristiques d’une civilisation orale, d’une civilisation, donc, ne faisant pas usage de l’écriture. Dans une culture orale primaire, privée d’écrit, la connaissance une fois acquise doit sans cesse être répétée, sauf à se perdre. Il faut donc éviter les analyses approfondies, dont il est impossible de retenir les chaînons logiques, et penser en utilisant des éléments dont le rythme affirmé aidera la mémorisation, tout en répétitions et bien sûr antithèses.
Le récit oral écarte un personnage qui pourrait à la fois être capable d’héroïsme et de vilenie, comme ceux des romans du XIXème siècle, qui sont l’aboutissement d’une culture écrite millénaire. Dans le récit oral, le héros unit en lui toutes les qualités physiques et spirituelles: il est beau, grand, fort, courageux, noble, généreux. Son adversaire au contraire est marqué de tous les stigmates du mal.
Parce qu’elle est incapable de développer une pensée un peu complexe, la culture orale tend à procéder par agglutination, elle est "sommaire": elle est la somme en effet des dépôt linguistiques qui constituent le patrimoine collectif; proverbes, lieux communs n’y sont pas occasionnels, ils forment la substance même de la pensée. La loi elle-même est gardée de cette façon. Enfin cette nécessaire répétition modèle une mentalité hautement traditionaliste et conservatrice qui interdit l’expérimentation intellectuelle, et fabrique un savoir statique éliminant les souvenirs inutiles au présent, et donc incapable de concevoir l’évolution, la progression historique.
Une civilisation orale se plaît donc fortement dans la lutte, parce qu’elle transfère son propre savoir, organisé en antithèses, dans la dynamique sociale, et elle est culturellement et historiquement statique. Dans le cas de l’Europe et de l’Occident, on peut distinguer un phénomène qui, s’il n’est pas aussi radical, demeure en substance analogue, dit "l’oralité de retour". Il est engendré par deux phénomènes concomitants. Le premier est l’extraordinaire diffusion d’un média technologique essentiellement oral, la télévision. Le second est la réaction de simplification psychologique face à ce qui est complexe.
L’analyse linguistique de ce moyen de communication permet d’identifier, parmi ses aspects typiques, l’usage de liens faibles: les propositions ne sont pas reliées, elles sont autonomes les unes par rapport aux autres. Le langage télévisuel est fragmenté. Or c’est la télévision qui a imposé l’oralité, et ses principaux aspects qu’a souligné avec efficacité le savant américain Walter Ong. Elle est agglutinante plus qu’analytique, elle est redondante, elle est statique. C’est la télévision qui élimine la mémoire devenue sans utilité pour le présent. Qu’on pense à l’actuel succès du révisionnisme historique, qui tend à réduire ou à nier l’holocauste, et à la désaffection en Italie pour les valeurs du Risorgimento et de la Résistance, dont le point commun consiste à réduire différences ou oppositions dans une vigoureuse tendance unificatrice.
En outre, aux yeux du téléspectateur, la télévision est toujours en direct, relativisant la progression du temps et mettant en acte une sorte d’éternel présent assorti d’un phénomène d’ubiquité. Mais la principale caractéristique de l’oralité secondaire véhiculée par la télévision tient à sa formulation de la pensée sous forme d’oppositions ou d’antithèses, puisqu’il faut mémoriser sans l’aide déterminante de l’écriture.
Ce n’est pas un hasard si l’Occident, qui a progressivement modelé en cinquante ans un imaginaire collectif polarisé et fortement antinomique s’est logiquement, géographiquement concrétisé dans le mur de Berlin, précisément construit avant l’ère de la télévision (1961); il l’a affublé d’un caractère épique avec la définition reaganienne toute biblique d’ "Empire du Mal" pour désigner l’Union Soviétique. Aujourd’hui, l’hypostase de l’"autre" s’est effondrée avec le mur de Berlin, que chacun craint et voit partout. Voilà qui peut arriver aussi bien dans les sociétés à technologie développée que dans celles où le niveau scolaire est faible, minime. Les murs de Berlin vont se multipliant.
Le développement démesuré du savoir et de la technologie de l’Occident contribue, avec la télévision, à cette oralité de retour. Non seulement personne aujourd’hui ne peut affirmer connaître tous les aspects de toutes les disciplines qui constituent l’ensemble du savoir de l’Occident, mais nul non plus ne peut affirmer avec certitude et tranquillité connaître tous les aspects de sa propre discipline ou de sa propre spécialité professionnelle. Souvent, sans la moindre intention socratique, les plus hautes autorités dans une discipline donnée doivent confesser leur impuissance à déterminer précisément leur champ d’étude, ainsi qu’on le voit pour les physiciens dans l’étude de la matière. Une telle richesse de savoir, fondée sur le renouvellement continuel de ses hypothèses, de ses expériences, de ses modèles, et cependant privée de la stabilité et de la durée qui caractérisaient le savoir de l’antiquité, constitue la force de l’Occident, mais aussi le plus faible maillon de sa chaîne: sauf en cas de catastrophe, les civilisations meurent d’excès de complexité.
Face à un savoir dont la démesure interdit à l’individu d’espérer jamais le posséder se développe un processus psychologique de simplification du système de pensée. La santé psychique exige des certitudes en petit nombre, mais inattaquables. C’est ainsi que lentement mais fortement se développe un système de pensée et de jugement qui abolit détails et nuances et les remplace par des schémas en noir et blanc, par des systèmes rudimentaires, mais efficaces. Il suffit d’évoquer la fin de la civilisation hellénistique ou celle de l’empire romain: ce que les Grecs appelaient barbarie consistait en une organisation mentale à coup sûr rudimentaire, mais apte à s’imposer aux facettes de l’antique civilisation, épuisée par sa propre complexité. La pensée antinomique et antithétique signe l’aube d’une civilisation, et son crépuscule.
Pour venir au devant de l’antithèse, quelle peut être la réponse de la synthèse, c’est à dire celle de la Franc-maçonnerie? Il semble que la réponse ne puisse que se proposer une finalité éthique, et viser deux scénarios complémentaires: l’un géopolitique et international, l’autre au niveau de la conscience individuelle.
Le premier scénario, qui a vu l’écroulement du duumvirat USA-URSS, traverse une phase extrêmement fluide. Il semble cependant probable qu’à cette première bipolarité s’en substitue une seconde, à la fois aussi conflictuelle que la première, mais fondée sur la complémentarité. Les pôles qui la constituent sont d’un côté les Etats-Unis, toujours, et de l’autre l’Orient. Le premier est fort de sa suprématie politique et militaire, le second est à un pas de la suprématie industrielle et commerciale.
Il n’est pas difficile de pronostiquer que la Communauté Européenne, se débattant dans ses incertitudes politiques et économiques, se réduira à un débouché commercial et politique de ce nouveau duumvirat: elle sera soumise. Il suffit d’envisager le retard de l’Europe dans le développement informatique, qui représente, soulignons-le, l’avenir des communications mondiales: comme si aux XVIIIème et XIXème siècles, l’Europe avait dû importer ses machines au lieu de les inventer, de les construire et de les vendre. Un troisième pôle serait nécessaire. Il donnerait à la planète un meilleur équilibre, la libérant du dualisme géopolitique qui tend à revenir malgré l’effondrement soviétique, et il est temps que l’Europe mette de côté ses complexes de culpabilité pour son passé récent belliqueux, et se tourne vers l’exploration du futur. Il ne s’agit pas là d’une option, mais d’un impératif que lui imposent la démographie et la crise de l’Occident dont elle est historiquement le repère cardinal.
Ce projet de construction d’un troisième pôle avec un barycentre européen, à long terme, mais pas à très long terme, la Franc-maçonnerie peut et doit s’en voir le protagoniste, elle devrait regrouper ses meilleures énergies dans cette direction. Elle devrait pousser le gouvernement italien à adopter une semblable politique communautaire et à la promouvoir en Europe, en la stimulant par des débats et des projets humanitaires sur ce problème, elle gagnerait à reconquérir son autorité aujourd’hui ligotée, et montrerait par les faits quels sont ses principes et les intentions qui l’animent. Une telle orientation internationale serait aussi accompagnée des projets pour le second scénario, celui de la conscience individuelle.
Au-delà du rigoureux et formateur travail sur nous-mêmes à l’intérieur de nos temples, il serait utile de rassembler les énergies qui se dispersent dans une multitude d’actes de bienfaisance dans la construction d’un organisme de formation, d’une université ou d’un établissement d’enseignement qui puisse accueillir les éléments les plus méritants sans distinction de niveau social, race, culture et religion, en finançant leurs études, et qui serait un lieu de dialogue et de tolérance: un exemple concret, tangible de la vision du monde qui inspire nos actions.
Si une direction doit marquer le chemin de l’Ordre maçonnique, c’est le fait de redevenir une autorité morale destinée à durer. Ce travail qu’il se déroule dans les Temples ou l’université - ou un centre d’études - devrait mettre au premier plan les sciences de la communication, domaine négligé, trop négligé par la Franc-maçonnerie. Il est superflu de rappeler quel rôle jouent aujourd’hui ces disciplines. Qu’on me pardonne le calembour, mais on pourrait dire que la parole s’est perdue au plan essotérique. Et ce n’est pas le cas dans les universités des Jésuites ou de l’Opus Dei, où les sciences de la communication jouent depuis toujours le premier rôle. Peut-être cela vient-il du fait qu’en Italie, les récentes campagnes de presse antimaçonniques ont obtenu un appréciable succès ? Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Arrêtons-nous ici: il suffit d’avoir suscité une réflexion sur ce thème. Du reste, il y a considérablement à faire: nous n’avons qu’à nous retrousser les manches. Mieux encore, à ceindre nos tabliers de travail.