ENCYCLOPÉDIE DE LA FRANC-MAÇONNERIE
01 type_Document_Title_here
BOULE
BOURGEOIS
BOURNEVILLE
BRAUNSGHWEIG
BRESIL
BOULE
Au terme d'une enquête con-duite par trois membres d'une loge*, des rapports sont lus devant l'atelier, avant la présentation du candidat qui sera inter-rogé, les yeux bandes. Un débat s'en-gage, suivi d'un vote qui s'opère obliga-toirement par boules blanches et noires. II s'agit là du souvenir de certains jeux lointains qui marquaient par ces boules le gain ou la perte et probablement de la survivance de traditions propres à des Clubs anglais très fermés qui signifiaient, par ces mêmes boules, l'accueil ou le re-fus du candidat à l'admission. Au Grand Orient de France* pour être favorable, ce vote doit recueillir moins du quart de boules noires. L'alternative est simple; elle écarte l'abstention, le vote nul ou le vote blanc. Assisté de l'orateur et du secrétaire, le vénérable* de la loge veille à la régularité du vote; chacun des votants exprime son choix par une couleur et remet l'autre boule dans une différente. Si le candidat est récusé, on dit alors qu'il est blackboulé (ce néologisme provient de l'anglais blackbalr). Ce type de vote intervient également lors d'un scrutin important dans la vie de la loge, quand la décision ne peut être prise à main levée.
Vl. B.
BOURGEOIS, Léon
{Paris 1851-l925)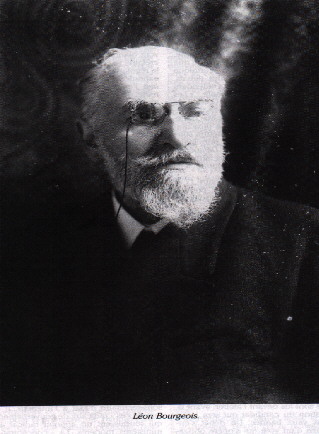 Ce ne sont pas ses réalisations gouverne-mentales qui ont valu à Léon Bourgeois d'occuper une place éminente dans la mémoire radicale. Dès l'approche de la cinquantaine, il a fui les responsabilités ministérielles pour devenir "le chanoine honoraire de la République" (Emile Combes*). Quand, exceptionnellement, il sort de sa réserve, c'est pour entrer dans des combinaisons gouvernementales qui ne plaisent guère aux radicaux de principe. C'est "une fort belle intelli-gence" jugeait Clemenceau, "il ne lui manque rien que le tempérament de l'ac-tion"
Ce ne sont pas ses réalisations gouverne-mentales qui ont valu à Léon Bourgeois d'occuper une place éminente dans la mémoire radicale. Dès l'approche de la cinquantaine, il a fui les responsabilités ministérielles pour devenir "le chanoine honoraire de la République" (Emile Combes*). Quand, exceptionnellement, il sort de sa réserve, c'est pour entrer dans des combinaisons gouvernementales qui ne plaisent guère aux radicaux de principe. C'est "une fort belle intelli-gence" jugeait Clemenceau, "il ne lui manque rien que le tempérament de l'ac-tion"
La gloire de Bourgeois a d'autres raisons: sa réputation de théoricien du radicalis-me*; le hasard qui l'a amené à diriger en 1899-1896 le premier ministère radical homogène de la Troisième République; son image de Wilson français qui, avant même la guerre de 1914, avait contribué à lancer l'idée de " Société des Na-tions*"
Bourgeois a commence sa carrière dans l'administration préfectorale. Sous-préfet à Reims, il est initié en 1882 par une loge locale, La Sincérité. Elu député de la Marne en 1888, il devient la même année sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Il est l'un de ces "radicaux de gouvernement" qui fournissent un appoint radical aux ministères modérés. La << concentration republicaine >> lui a valu six maroquins entre 1888 et 1893. En novembre 1895, les péripéties parlementaires conduisent Bourgeois à prendre la tête d'un cabinet radical qui dure six mois. Fortement ma-çonnisé (avec notamment Mesureur* Doumer* et Combes), ce ministère bénéficie du soutien socialiste, et Bourgeois, un peu contre son gré, fait figure de précurseur du Bloc des Gauches. Toute une France conservatrice et modérée s'effraie de la collusion des ministres avec le " col-lectivisme " et, en avril 1896, Bourgeois se retire devant l'obstruction du Sénat.
Il a publié en I896 un petit livre, Solida-rité . Le << Solidarisme >, va devenir une manière de doctrine sociale officielle de la Troisième République. Ce courant de pensée, écrit Bougle en 1907, est "le four-nisseur attitré de ces grands thèmes moraux qui font l'accord des consciences et que le moindre personnage public se sent obligé de répéter aux occasions so-lennelles" Bourgeois n'a pas inventé le mot " solidarité " que Pierre Leroux vou-lait déjà substituer à "charité chrétienne". L'outillage conceptuel qu'il mobi-lise pour justifier "scientifiquement " le réformisme social du programme radical est emprunté à d'autres, notamment au philosophe Fouillée, à qui l'on doit la no-tion de "quasi-contrat". Bourgeois donne aux radicaux l'assurance de disposer d'une doctrine qui fonde en raison l'inter-ventionnisme social de l'Etat, sans aller jusqu'au collectivisme, sans non plus rat-tacher l'obligation de justice sociale à un impératif religieux. Plus que la construc-tion théorique de Bourgeois, c'est le mot même de solidarité qui fait fortune dans le discours radical, et la maçonnerie avait largement préparé le terrain. "C'est sur la grande loi de solidarité, peut on lire dans un rituel de "reconnaissance conju-gale" élaboré par Blatin*, que reposent scientifiquement et inébranlablement les principes moraux que nous enseignons dans nos temples". Protestant, au Con-vent* de 1894, contre le reproche fait aux maçons d'être des << bourgeois égoïstes >>, Bourceret les qualifiait de "solidaristes pratiques ". Et c'est encore au nom du solidarisme que les maçons radicaux ten-dent la main aux socialistes :"Nous som-mes les premiers, déclare Lucipia* en 1895, à avoir prêché les idées de solidarité, c'est à dire de socialisme pratique, qui transforment la société".
Pendant le ministère Méline (1896-1898), Bourgeois fait figure de leader de l'oppo-sition. Il va porter en province la bonne parole républicaine et anticléricale, à l'appel des comités radicaux et bien sou-vent des loges. La maçonnerie, proclame--t-il à Toulouse, est "inséparable de l'idée de la République ". Mais l'affaire Drey-fus* le dégoûte de cet activisme. Ministre de l'lnstruction publique dans le cabinet Brisson* de 1898, il scandalise les dreyfu-sards en sévissant contre des universitai-res acquis à la cause de la révision. En 1899, au moment de la crise qui va con-duire à la formation du ministère Wal-deck-Rousseau, il refuse, malgré les ins-tances de ses amis politiques de former le gouvernement (" Je ne suis pas l'homme des besognes "). Il prive ainsi le radicalisme de l'honneur d'animer la défense républicaine. Cette "fuite éperdue " (Clemenceau) sera sévèrement jugée Quand Bourgeois parraine, deux ans plus tard, le congrès de fondation du Parti radical, Lafferre (futur président du Conseil de l'Ordre) se dit peu rassuré par la caution d'un homme qui, à l'heure décisive, a " refuse de partager les responsabilités ". Il refuse encore le pouvoir en 1902, préférant la présidence de la Cham-bre, qu'il exerce jusqu'à la fin de 1903. Il ne surmontera sa répugnance pour le pou-voir qu'en 1906 (ministre des Affaires étrangères dans le cabinet Sarrien), 1912 (ministre du Travail de Poincaré}, 1914 (ministre des Affaires étrangères dans le cabinet mort-né de Ribot). Pendant la guerre, il sera ministre d'Etat dans des gou-vernements d'Union sacrée*. Bourgeois est régulièrement tancé par la presse radi-cale pour ses défaillances et son dilettan-tisme, mais son éloquence fleurie reste appréciée des militants, qui lui savent gré de conférer une sorte de dignité philoso-phique à la doctrine du parti.
Bourgeois compense son abstention poli-tique par un fort investissement dans les oeuvres laïques et sociales, ainsi que dans le mouvement pacifiste. Il a présidé la Li-gue de l'Enseignement de 1894 à 1898. Il préside ou anime toutes sortes d'associa-tions de prévoyance sociale. En 1900, il a préside la commission d'organisation du Congrès international de l'éducation so-ciale. Chef de la délégation française aux deux conférences de la Paix tenues à La Haye en 1899, il publie en 1910 Pour la Société des Nations, où il milite pour la substitution de l'arbitrage international à la guerre. En 1919, il représente la France à la commission qui élabore le Pacte de la SDN, mais il ne parvient pas à faire adopter la création d'une force armée in-ternationale. Honoré en 1920 du prix No-bel de la Paix, il connaît ses derniers succès oratoires à l'assemblée de Genève.
G. B.
BOURNEVILLE Désiré
(Garencières, 1840 Paris, l909)
Né de Charles Alexan-dre Marcel Bourneville, propriétaire agri-culteur, et de Rose Clémentine Legras, sa cousine germaine, Désiré Bourneville fréquente le lycée d'Evreux, puis celui d'Alençon. Il fait ses études de médecine à Paris; alors qu'il est interne des hôpi-taux, il part pour Amiens participer à la lutte contre l'épidémie de choléra (1866). Il écrit dans quelques journaux de médecine, La Médecine contemporaine, Le Mouvement médical, Les Annales de l'hydrothérapie. Il se lie aux milieux publicains; en 1867, il collabore au Panthéon de l'industrie et des arts, fondé par Charles Delescluze. Il achève ses études en 1870, soutenant une thèse intitulée Etudes de thermochimie clinique dans l'hémorragie cérébrale et dans quelques autres maladies de l'encéphale. Pendant la guerre franco-prussienne, il est nommé aide major au 160e bataillon de la garde nationale de la Seine et demeure à son poste pendant la Commune*. En 1871, il est nommé assistant de Charcot à la Sal-petrière. En 1873, il fonde Le Progrès médical, dont il devient le directeur. La même année, il figure dans le Comité fédéral républicain chargé de soutenir la candidature de Désiré Barodet contre celle de Charles de Rémusat. Lors des élections législatives de 1877-date à laquelle il devient conseiller municipal de Paris-et de 1881, il est membre du comité électoral qui assure l'élection de Louis Blanc dans la Ire circonscription du Ve arrondissement. Bourneville milite ac-tivement dans cet arrondissement; ainsi il siège au comité d'administration de la bibliothèque des Amis de l'instruction publique. Conseiller municipal, il est le grand artisan de la laïcisation des hôpitaux de l'Assistance publique; il fonde quatre écoles pour la formation des infirmières laïques destinées à remplacer les congréganistes. En 187S, il devient médecin chef du service des enfants épileptiques à l'hospice de Bicêtre. Louis Blanc étant décédé en 1882, Bourneville se présente comme candidat radical-socialiste et est élu; dans son programme, la sépa-ration des Eglises et de l'Etal figure en bonne place. Ayant été réélu en 1885, il est encore député lorsqu'il épouse Maria Breugnon le 22 juin 1887; le mariage semble bien avoir été exclusivement civil et son fils unique, Marcel, né le 12 juillet 1887, n'est pas baptisé. Cela correspond bien aux engagements du Dr Bourneville, membre du groupe Etienne-Dolet, société de libre pensée* du Ve arrondisse-ment, et fondateur, en 1882, d'une société de libre pensée à Gentilly (Seine). De nouveau candidat aux élections législatives de 1889, Bourneville est battu par le candidat boulangiste, Alfred Naquet celui-ci ayant été invalidé, de nouvelles élections ont lieu et Bourneville est battu une seconde fois, en mars 1890.
Le 21 janvier 1891, il est initié à la loge La Clémente Amitié; il ne dépasse pas le grade d'apprenti* et devient honoraire le 21 novembre 1906. Entre temps, en 1896, 1897, 1899 et 1900, il avait vainement bri-gué les suffrages des délégués sénatoriaux. En 1902, il adhère à l'Association nationale des libres penseurs de France. Il meurt le 29 mai I909 et, conformément à son désir, son corps est incinéré au crématorium du Père-Lachaise. Sa fin est ainsi conforme à ses engagements, en ef-fet il avait été un ardent crématiste et avait reçu la présidence de la Société française pour la propagation de la crémation en 1890, puis avait été nommé membre du Comité de perfectionnement des services de la crémation par le préfet Poubelle.
Ainsi, si le Dr Bourneville, initié sur le tard, fut un maçon peu actif, du moins défendit il dans la société profane diver-ses causes qui étaient chères à la franc-maçonnerie.
J. L.
BRAUNSGHWEIG
 en français: Brunswick)
Cette maison princière allemande comprit de nombreux francs-maçons. Le duché de Braunschweig et Lüneburg fut crée par l'empereur Frédéric II en 1235. Le duc régnant Ferdinand Albrecht II, mort en 1735, eut 5 enfants.
Son fils aîné, le duc régnant Karl Ie (1713--1780) duc de Braunschweig-Bevern et depuis 1735 duc de Braunschweig-Lüne-burg, épouse Philippine Charlotte (1716-1801) sœur de Frédéric* le Grand. Karl ler fut protecteur de la loge de Braunschweig sans être franc-maçon.
Elisabeth Christina (1715-1797) épouse Frédéric le Grand le 12 juin 1733. Ferdinand (Wolfenbüttel 12 janvier 1721,-Brunswick, 3 juillet 1792), duc de Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel, est une personnalité centrale de l'histoire de la Stricte Observance*. Proposé par son beau-frère, le prince August-Wilhelm, il est initié à Berlin par la loge Aux Trois Globes le 21 décembre 1740 et élevé à la maîtrise à Breslau par la loge Aux Trois Squelettes le 7 juillet 1742. Au cours de la guerre de Succession d'Autriche, il ac-compagne en 1741 Frédéric qui le décore de l'Ordre de l'Aigle Noir. Schröder* (1806) indique qu'il est reçu Chevalier de Saint-André à Berlin en 1745. Vainqueur du comte de Clermont à Krefeld (23 juin 1758), promu maréchal, il est nommé gouverneur de Magdebourg une fois la guerre de Sept Ans terminée. Il se retire en 1766 près de Brunswick dans son château de Vechelde. En mai 1770, il ac-cepte la charge de Grand Maître Provin-cial, que lui offre le duc de Beaufort, Grand Maître de la Grande Loge d'Angle-terre (Modernes*). Mais ayant assisté à Brunswick, le 15 janvier 1771 à une te-nue* rituelle des quatre premiers grades de la Stricte Observance il " abandonne la franc-maçonnerie anglaise " (Gould*) et devient deux jours plus tard amicus et protector de la Stricte Observance avec pour nom d'ordre Eq. a Victoria. Elu Grand Maître de toutes les loges écossaises avec le titre de magnus superior ordi-nis au cours du Convent* de Kohlo, le 23 juin 1772, installé à Brunswick le 21 octobre suivant dans le Chapitre de Préfecture présidé par Lestwitz, il en fait part à lord Petre. En janvier 1773, il visite deux fois la loge La Candeur à Stras-bourg. Une médaille reproduite par Bugge (1855), et qui représente un lion jouant avec des instruments de mathématiques et dont la légende est: Veni, vici, quiesco, est gravée en son honneur, ce dont la loge de Strasbourg est informée au mois de juin suivant. Après le Convent de Brunswick (mai juillet 1775), il a plu-sieurs entretiens secrets avec von Hund* qui lui remet la plupart des archives* et de la correspondance de la Stricte Obser-vance (les archives du duc Ferdinand fu-rent ensuite placées sous scellés par ses créanciers). Le directoire, dont la création à Dresde avait été décidée au Con-vent de Kohlo, siège désormais à Bruns-wick. En décembre 1776, un mois après la mort de von Hund, le duc Charles de Södermanland exprime par écrit au duc Ferdinand son vécu d'un rapprochement entre le Grand Chapitre de Suède et la Stricte Observance. Le 29 juin 1778, le duc Ferdinand reçoit les hauts grades* suédois au château de Maltesholm. Le 15 juillet 1778, il ouvre les travaux du Convent de Wolfenbüttel qui élit le duc Charles Ordens + Meister de la Vlle Pro-vince, le duc Ferdinand conservant son titre de magntus supenor ordinis. L'al-liance est ratifiée le 2 septembre 1779. Sans en prévenir les autres Provinces de l'Ordre, le duc Charles décide alors de restaurer en Suède la IXe Province. Il est installé à sa tête le 15 mars 1780 et l'an-nonce un mois plus tard au duc Ferdi-nand. Le Directoire de Brunswick mar-que sa stupeur et sa désapprobation dans plusieurs lettres adressées à Stockholm. Lorsque, au cours de la réunion du 5 février 1781, le Grand Chapitre suédois ap-prend l'intention du duc Ferdinand de convoquer un convent général cinq mois plus tard, il adresse au Directoire une cir-culaire du duc Charles exprimant son opposition à ce projet et interdisant aux membres de la Vlle Province d'y assister. La lettre du directoire du 28 mars en réponse à cette circulaire amène l'abdi-cation du duc Charles à la tête de la Vlle Province qu'il rend publique par une très longue lettre du 10 avril 1781 motivant sa décision. Le convent général se tiendra à Wilhelmsbad au cours de l'été 1782 sous la présidence du duc Ferdi-nand qui y est nommé Grand Maître Général de l'Ordre. En 1784, le duc devient membre des Illumines sous le nom de Josephus et, en 1786, membre des Frères d'Asie*. Son décès coïncida avec la dis-parition de la Stricte Observance.
en français: Brunswick)
Cette maison princière allemande comprit de nombreux francs-maçons. Le duché de Braunschweig et Lüneburg fut crée par l'empereur Frédéric II en 1235. Le duc régnant Ferdinand Albrecht II, mort en 1735, eut 5 enfants.
Son fils aîné, le duc régnant Karl Ie (1713--1780) duc de Braunschweig-Bevern et depuis 1735 duc de Braunschweig-Lüne-burg, épouse Philippine Charlotte (1716-1801) sœur de Frédéric* le Grand. Karl ler fut protecteur de la loge de Braunschweig sans être franc-maçon.
Elisabeth Christina (1715-1797) épouse Frédéric le Grand le 12 juin 1733. Ferdinand (Wolfenbüttel 12 janvier 1721,-Brunswick, 3 juillet 1792), duc de Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel, est une personnalité centrale de l'histoire de la Stricte Observance*. Proposé par son beau-frère, le prince August-Wilhelm, il est initié à Berlin par la loge Aux Trois Globes le 21 décembre 1740 et élevé à la maîtrise à Breslau par la loge Aux Trois Squelettes le 7 juillet 1742. Au cours de la guerre de Succession d'Autriche, il ac-compagne en 1741 Frédéric qui le décore de l'Ordre de l'Aigle Noir. Schröder* (1806) indique qu'il est reçu Chevalier de Saint-André à Berlin en 1745. Vainqueur du comte de Clermont à Krefeld (23 juin 1758), promu maréchal, il est nommé gouverneur de Magdebourg une fois la guerre de Sept Ans terminée. Il se retire en 1766 près de Brunswick dans son château de Vechelde. En mai 1770, il ac-cepte la charge de Grand Maître Provin-cial, que lui offre le duc de Beaufort, Grand Maître de la Grande Loge d'Angle-terre (Modernes*). Mais ayant assisté à Brunswick, le 15 janvier 1771 à une te-nue* rituelle des quatre premiers grades de la Stricte Observance il " abandonne la franc-maçonnerie anglaise " (Gould*) et devient deux jours plus tard amicus et protector de la Stricte Observance avec pour nom d'ordre Eq. a Victoria. Elu Grand Maître de toutes les loges écossaises avec le titre de magnus superior ordi-nis au cours du Convent* de Kohlo, le 23 juin 1772, installé à Brunswick le 21 octobre suivant dans le Chapitre de Préfecture présidé par Lestwitz, il en fait part à lord Petre. En janvier 1773, il visite deux fois la loge La Candeur à Stras-bourg. Une médaille reproduite par Bugge (1855), et qui représente un lion jouant avec des instruments de mathématiques et dont la légende est: Veni, vici, quiesco, est gravée en son honneur, ce dont la loge de Strasbourg est informée au mois de juin suivant. Après le Convent de Brunswick (mai juillet 1775), il a plu-sieurs entretiens secrets avec von Hund* qui lui remet la plupart des archives* et de la correspondance de la Stricte Obser-vance (les archives du duc Ferdinand fu-rent ensuite placées sous scellés par ses créanciers). Le directoire, dont la création à Dresde avait été décidée au Con-vent de Kohlo, siège désormais à Bruns-wick. En décembre 1776, un mois après la mort de von Hund, le duc Charles de Södermanland exprime par écrit au duc Ferdinand son vécu d'un rapprochement entre le Grand Chapitre de Suède et la Stricte Observance. Le 29 juin 1778, le duc Ferdinand reçoit les hauts grades* suédois au château de Maltesholm. Le 15 juillet 1778, il ouvre les travaux du Convent de Wolfenbüttel qui élit le duc Charles Ordens + Meister de la Vlle Pro-vince, le duc Ferdinand conservant son titre de magntus supenor ordinis. L'al-liance est ratifiée le 2 septembre 1779. Sans en prévenir les autres Provinces de l'Ordre, le duc Charles décide alors de restaurer en Suède la IXe Province. Il est installé à sa tête le 15 mars 1780 et l'an-nonce un mois plus tard au duc Ferdi-nand. Le Directoire de Brunswick mar-que sa stupeur et sa désapprobation dans plusieurs lettres adressées à Stockholm. Lorsque, au cours de la réunion du 5 février 1781, le Grand Chapitre suédois ap-prend l'intention du duc Ferdinand de convoquer un convent général cinq mois plus tard, il adresse au Directoire une cir-culaire du duc Charles exprimant son opposition à ce projet et interdisant aux membres de la Vlle Province d'y assister. La lettre du directoire du 28 mars en réponse à cette circulaire amène l'abdi-cation du duc Charles à la tête de la Vlle Province qu'il rend publique par une très longue lettre du 10 avril 1781 motivant sa décision. Le convent général se tiendra à Wilhelmsbad au cours de l'été 1782 sous la présidence du duc Ferdi-nand qui y est nommé Grand Maître Général de l'Ordre. En 1784, le duc devient membre des Illumines sous le nom de Josephus et, en 1786, membre des Frères d'Asie*. Son décès coïncida avec la dis-parition de la Stricte Observance.
Luise Amélie (1722-1780) épouse le prince Auguste Guillaumme de Prusse, frère de Frédéric le Grand.
Albrecht (4 mai 1725-30 septembre 1745), prince de Braunschweig-Lüneburg, est initié à Brunswick par la loge Jonathan le 27 décembre 1744.
Fils aîné de Karl ler, le duc régnant Karl -Wilhelm Ferdinand (9 octobre 1735--10 novembre 1806), célèbre général et vaincu de Valmy, ne fut pas franc-maçon, mais ses trois frères cadets ont appartenu à la Stricte Observance.
Friedrich Auguste (29 octobre 1740-8 oc-tobre 1805), duc de Braunschweig-Lüne-burg en 1780, épouse une princesse de Wurtemberg et hérite d'Oels en 1792. Général au service de la Prusse, il libère Brunswick de l'occupation française pen-dant la guerre de Sept Ans, ce qui lui at-tire les faveurs de Frédéric. Commandant de Küstrin de 1764 à 1779. La date de son initiation* est inconnue. Il est membre de la Stricte Observance le 4 décembre 1771, avec le titre de socius amtcus et fautor ordinis, commé par von Hund Préfet de Templin (Berlin), le 27 avril 1772. Installé Grand Maître National de la Mère Loge* Aux Trois Globes, le 2 novembre 1772, il préside en cette qualité à l'initia-tion du prince Friedrich, futur roi du Wur-temberg, et de son frère le prince Ludwig, le 9 janvier 1776. Il démissionne en février 1799.
Wilhelm Adolphe (18 mai 1745-24 août 1770), prince de Braunschweig, est initié le 14 décembre 1769.
Maximilien Julius Léopold (11 octobre 1752-27 avril 1785), duc de Braunschweig en 1780, est reçu maçon à Brunswick, à la loge Saint-Charles de la Concorde, le 11 octobre 1770.
A. B.
BRESIL
Bien que le Brésil ait accueilli de nombreux francs-maçons (venant pour la plupart du Portugal*) dès la moi-tie du XVllle siècle, la premier loge* dûment structurée n'est apparue en Amérique portugaise qu'en 1800. Il s'agit de la loge Union, mise en place près de Rio de Janeiro, à Niteroi. Pratiquant le Rite Adonhiramite, elle disparaît en 1801 sans jamais avoir intégré d'obédience*. Cette même année apparaît Réunion, une se-conde loge pratiquant le même rite. Elle est peut-être issue de la transformation de la première. Elle s'installe à Rio de Ja-neiro et se place sous les auspices de l'île Maurice alors appelée île de France (1803). Elle cesse ses activités en1805. La loge Vertu et Raison, pratiquant le Rite Français*, s'installe à Bahia en 1802.
Mais le Grand Orient Lusitanien, crée à Lisbonne en 1802, intervient bientôt. En 1804, il soutient l'installation sous son autorité de deux loges, Constance et Philan-tropie, qu'il considère comme étant les seules loges légitimes et qui par la suite entrent en compétition avec les autres. Néanmoins, la persécution mise en oeu-vre par le vice-roi, le comte dos Arcos conduit à leur fermeture. Seule la loge de, Bahia survit, difficilement.
A partir de 1807-1808, la franc-maçonnerie renaît grâce à un régime plus tolérant. La présence de la cour du Portugal et de nombreux francs-maçons émigrés portu-gais est un atout pour l'établissement suc-cessif de loges à Rio de Janeiro, Bahia. au Pernambouco, où la franc-maçonnerie prend énormément d'ampleur, et à Nite-roi. Elles pratiquent soit le Rite Adonhira-mite, soit le Rite Français. Le premier Grand Orient Brésilien est constitué en 1813, et ne regroupe que trois loges de Bahia et une loge de Rio de Janeiro. An-tonio Carlos Ribeiro de Andrada, frère de José Bonifacio de Andrada* e Silva, en est le Grand Maître. De même, le Grand Orient Lusitanien place deux loges de Rio de Janeiro sous son obédience.
Les persécutions de 1817- 1818, de la même veine que celles du Portugal mènent à la fermeture temporaire de toutes les loges franc-maçonniques du Brésil et à l'extinction du Grand Orient Brésilien A partir de 1820-1821, les mesures prises par la Cour du Portugal et le retour dans ce pays de D. Joao Vl permettent la re-naissance de la franc-maçonnerie qui adopte une politique clairement antipor-tugaise et indépendantiste. Les loges Commerce et Arts et Union et Tranquillité de Rio de Janeiro, ainsi que Espoir de Ni-teroi, fondent en juin 1822, et sous l'autorité suprême de José Bonifacio de An-drada e Silva, le Grand Orient du Brésil dont le rôle est indéniable dans la procla-mation de l'indépendance Le 7 sep-tembre de cette même année. En août 1822, le régent D. Pedro est initié dans l'une d'elles. Peu après, il est élevé au grade* de maître*, puis devient Grand Maître au début du mois d'octobre alors qu'il est déjà empereur. Le nouveau sou-verain ne tarde pas à redouter le contrôle excessif de la franc-maçonnerie sur la politique brésilienne et s'empresse d'or-donner la fermeture des loges et la sus-pension de tous les travaux franc-maçonniques. Les francs-maçons brésiliens vivent dans la clandestinité jusqu'en 1831 et quelques-uns se regroupent en ateliers indépendants ou se placent sous l'autorise du Grand Orient de France*. En 1829, l'un d'eux commence à pratiquer le Rite Ecossais Ancien et Accepte*. Cette même année le Suprême Conseil du 33° de Belgique* accorde à Francisco Monte-zuma ambassadeur du Brésil dans ce pays, l'autorisation de constituer au Brésil et dans la mesure du possible, le premier Suprême Conseil de ce rite.
En 1831, après l'abdication de Pedro 1e, on pouvait compter deux obédiences au Brésil: l'ancien Grand Orient du Brésil et le nouveau Grand Orient Brésilien dont les origines remontent à l'époque de la clandestinité. A chacun d'eux est associé un Suprême Conseil du 33°. L'un est fondé par Montezuma en 1832. L'autre, fondé l'année suivante se fait se connaî-tre par les Etats-Unis et la France. A partir de 1835, diverses scissions et unions af-fectent ces Suprêmes Conseils, qui ne réussissent à s'unifier qu'en 1854. En ce qui concerne les degrés symboliques, un troisième Grand Orient et par conséquent un nouveau Suprême Conseil, est créé. Par la suite, les deux plus anciens Grands Orients fusionnent. Les loges, qui travail-laient selon les Rites Adonhiramite, Français et Ecossais Ancien et Accepte, se multiplient et se répandent dans plu-sieurs provinces de l'empire.
En 1863, le Grand Orient Brésilien se di-vise en deux. Les dissidents, aux idées anticléricales et républicaines, conservent malgré tout, eux aussi, le nom de Grand Orient Brésilien. Ils sont cependant sou-vent appelés "Grand Orient des Bénédictins", du nom de la rue de Rio de Janeiro où est établi leur siège. L'autre Grand Orient du Brésil, plus conservateur et mo-narchiste, prend quant à lui le nom d'orient "Lavradio", également selon le nom de la rue où il est localisé. Durant les décennies qui suivent, on assiste à une grande expansion du premier tandis que le second stagne. En 1873, le Grand Orient des Bénédictins compte 216 loges contre 56 pour le Grand Orient de Lavradio. Néanmoins, tous deux s'engagent dans la lutte contre le cléricalisme et sont victimes de discrimination de la part de l'Eglise ca-tholique. Le conflit entre francs-maçons et cléricaux oblige l'empereur Pedro II à intervenir lui-même, en faveur des pre-miers Cette période se caractérise par la création des premières loges féminines (rite d'adoption*), par l'introduction du Rite de York-Emulation* et par la partici-pation de la franc-maçonnerie brésilienne aux grandes causes sociales et humani-taires comme la lutte contre l'esclavage et l'analphabétisme.
Apres une première tentative (qui échoue en 1872), les deux Grands Orients et leurs Suprêmes Conseils res-pectifs fusionnent pour ne former qu'une seule obédience*, le Grand Orient, Suprême Conseil du Brésil. Elle compte 139 loges, dont 48 à Rio de Janeiro. Le mouvement en faveur de la décentralisation conduit à la fondation progressive de Grandes Loges et de Grands Orients dans ce qui était autrefois des provinces et allait devenir des Etats. La franc-maçonnerie brésilienne inscrit de nombreu-ses réussites au palmarès de son interven-tion dans le monde profane, dont l'abolition de l'esclavage (1888), la proclamation de la République C1889) et la séparation de l'Eglise et de l'Etat (1890). Une grande partie de l'opinion publique la plus éclairée travaille dans les loges et la quasi-totalité des présidents de la nou-velle République, ainsi que de nombreux ministres, parlementaires et chefs locaux, sont francs-maçons. Grâce à la politique de décentralisation menée par l'Etat, l'ex-pansion des loges est considérable (440 en 1914, sans compter les loges étrangères). En 1914, apparaît, outre les rites tra-ditionnels, le Rite Brésilien. Dans le domaine social, on crée la Bienfaisance franc-maçonnique, qui exerce une fonc-tion d'assistance et de mont de piété, ainsi que plusieurs sociétés de secours mutuels et d'enseignement. La scolarisa-tion des fils de francs-maçons devient d'ailleurs obligatoire.
Cette période d'unité, malgré quelques pe-tites dissidences sans importance, et d'ex-pansion homogène prend fin en 1927. La séparation décrétée entre un Grand Orient symbolique et un Suprême Conseil du 33° soulève de tels problèmes qu'on déclare la séparation totale entre le Grand Orient du Brésil et le Suprême Conseil du 33°. Ce der-nier supervise de Grandes Loges, instituées progressivement dans différents Etats dans le but de créer et d'administrer des loges symboliques. Le fléau des scissions et des "sous scissions" continue de sévir les décennies suivantes, aggravé par des ques-tions de "régularité*"et "d'irrégularité". C'est ainsi que se détachent du Grand Orient du Brésil la Grande Loge du Brésil (1945) et les Grands Orients indépendants fondés dans différents Etats (1973) Ceux-ci se regroupent par la suite en une Confédération Franc-maçonnique brésilienne. Néanmoins, le Grand Orient du Brésil continue de constituer un des piliers de la Franc-maçonnerie brésilienne. Il compte en effet des dizaines de milliers de frères et des centaines de Loges en activité.
L'organisation franc-maçonnique brésilienne est la plus importante d'Amérique latine et son influence s'exerce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Des organisations humanitaires et culturelles du plus grand intérêt comme l'Ordre para-maçonnique De Molay s'occupant de la protection des jeunes adolescents ont été fondées sous son autorité
J.J.A.D. et A.H. de O.M.
-