G
GAGES, François Bonaventure du Mont, marquis de
GAMBETTA,Léon
GANTS
GARIBALDI, Giuseppe
GARNIER, Pierre-Dominique
GARNIER-PAGÈS, Étienne
GARNIER-PAGÈS, Louis
GASTAUD, André
GENÈVE
GENTILY, Anne-Marie, née Pédenau
GIRAUD, Sébastien
G
 La lettre G apparaît au centre du pentagramme, l'étoile flamboyante à cinq branches qui est remis à l'initié lorsque celui-ci accède au grade de compagnon*. Elle est signalée en 1730 dans la Maçonnerie disséquée de S. Prichard, où l'apprenti* dit avoir été fait compagnon de métier « pour l'amour de la lettre G », laquelle désigne « la géométrie ou cinquième science « plus loin la « ressemblance de la lettre G » renvoie au Grand Architecte* et Ordonnateur de l'Univers ou à « Celui qui fut hissé sur le sommet du pinacle du Temple saint ».
La lettre G apparaît au centre du pentagramme, l'étoile flamboyante à cinq branches qui est remis à l'initié lorsque celui-ci accède au grade de compagnon*. Elle est signalée en 1730 dans la Maçonnerie disséquée de S. Prichard, où l'apprenti* dit avoir été fait compagnon de métier « pour l'amour de la lettre G », laquelle désigne « la géométrie ou cinquième science « plus loin la « ressemblance de la lettre G » renvoie au Grand Architecte* et Ordonnateur de l'Univers ou à « Celui qui fut hissé sur le sommet du pinacle du Temple saint ».
L' instruction complémentaire sur le sens de la lettre mystérieuse entraîne la réponse suivante: « Par lettre quatre et science cinq ce G se tient en juste art et proportion. » Les interprètes anglais s'accordent pour y reconnaître l' initiale du mot God (Dieu) et celle de « géométrie » souvent identifiée comme la cinquième science dans les arts libéraux. Les Old Charges* ignoraient la lettre G. comme de nombreux textes postérieurs à Prichard, tout en associant la géométrie à la maçonnerie. On le voit notamment dans les Carnets de Villard de Honnecourt (milieu du XIIIe siècle) qui portent « iométrie » suggérant la substitution du G à l'lod hébraïque qui désigne le nom de Dieu. Dante donne également la lettre I comme premier nom de Dieu et des rituels anglais du Rite Émulation*, au grade de compagnon, précisent que des lettres hébraïques ont pu être symbolisées par le G comme Grand Géomètre de l'Univers. Les mots sacrés commençant aux différents rites par J (Jehovah, Jabulon...) invitent, il est vrai, à cette substitution. René Guénon* enfin a relevé la ressemblance du gamma majuscule grec avec l'équerre* des maçons (branches de valeur 4 et 3), quatre gamma formant un carré parfait de côté 7. Le mot anglais square désigne le carré et l'équerre.
J.-P. L.
GAGES, François Bonaventure du Mont, marquis de
 (Mons, 1739-1787) Après avoir suivi les cours du collège des jésuites à Mons et étudié le droit à l'université de Louvain, à la mort de son père, François Bonaventure du Mont devient l'unique héritier de celui-ci et de son oncle Jean Baptiste Bonaventure du Mont, lieutenant général des armées du roi d'Espagne et vice-roi de Navarre. Il adresse à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche* une requête qui lui permet d'assumer le titre de marquis. Il épouse, le 5 octobre 1761, sa cousine Alexandrine de Bousies: deux enfants seront issus du couple. En 1766, le marquis est admis à la Chambre de la noblesse des États du Hainaut puis, en 1767, il est nommé chambellan de leurs Majestés impériales, royales et apostoliques. Ce titre honorifique lui donne accès à la cour du gouverneur des Pays-Bas autrichiens*. En 1784, il obtient l'autorisation d'ajouter des ornements à son blason et atteint le sommet de sa carrière de courtisan.
(Mons, 1739-1787) Après avoir suivi les cours du collège des jésuites à Mons et étudié le droit à l'université de Louvain, à la mort de son père, François Bonaventure du Mont devient l'unique héritier de celui-ci et de son oncle Jean Baptiste Bonaventure du Mont, lieutenant général des armées du roi d'Espagne et vice-roi de Navarre. Il adresse à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche* une requête qui lui permet d'assumer le titre de marquis. Il épouse, le 5 octobre 1761, sa cousine Alexandrine de Bousies: deux enfants seront issus du couple. En 1766, le marquis est admis à la Chambre de la noblesse des États du Hainaut puis, en 1767, il est nommé chambellan de leurs Majestés impériales, royales et apostoliques. Ce titre honorifique lui donne accès à la cour du gouverneur des Pays-Bas autrichiens*. En 1784, il obtient l'autorisation d'ajouter des ornements à son blason et atteint le sommet de sa carrière de courtisan.
Il est vraisemblable qu'il a entamé sa carrière maçonnique en France comme en témoigne sa correspondance avec le comte de Clermont Grand Maître de la Grande Loge de France*. Ce dernier l'aurait nommé à la tête d'une Grande Loge Provinciale à Mons, vers 1760. En 1770, les loges des Pays-Bas autrichiens dépendent d'au moins quatre Grandes Loges la Grande Loge d'Angleterre la Grande Loge de France, la Grande Loge des Pays-Bas et peut-être la Grande Loge d'Écosse*. L'ambition du marquis vise à l'unification de ces loges sous une seule autorité. Il espère arriver à ses fins avec l'appui du comte de Clermont mais la détérioration de la Grande Loge de France l'amène à introduire une demande de patente auprès de la Grande Loge d'Angleterre qui a fondé deux loges dans les Pays-Bas autrichiens, à Alost (La Discrète Impériale, sous le n° 34, reçoit une patente le S juin 1765) et à Gand (La Constante Union sous le n° 427 dont la patente est datée de juillet 1768). Il entre en relation avec le marquis de Vignoles, Grand Maître Provincial pour les loges d'outre-mer. Malgré ce titre prestigieux, il est simplement l'adjoint du Grand Secrétaire pour la correspondance étrangère. En janvier 1770, la Grande Loge d'Angleterre délivre une patente à la loge La Parfaite Harmonie, à Mons sous le no 394, tout en l'instituant Grande Loge Provinciale, et, deux jours plus tard, une patente de Grand Maître Provincial pour les Pays-Bas autrichiens est délivrée au nom du marquis de Gages. Il va créer une véritable entité autonome, négliger les paiements à effectuer à Londres délivrer des patentes qui ne lui sont jamais enregistrées à des gens de qualité. Il réunit sa Grande Loge Provinciale au moins huit fois et visite fréquemment ses loges. En 1786, 23 loges reconnaissent son autorité et les listes publiées ou conservées démontrent une grande activité. À Ostende, une loge est fondée par une patente datée du 10 mars 1784, nº 223, par la Grande Loge dite des Anciens*. De même, les loges de la principauté de Liège ne se trouvent pas sous son autorité. Quand Joseph II succède à sa mère la franc-maçonnerie en subit les effets puisque le nombre de loges est limité à trois dans la capitale des États. Le marquis de Gages va tenter d'éviter la disparition de son oeuvre, mais ni Vienne, sollicitée en premier pour s'y intégrer, ni le Grand Orient de France*, pour obtenir une reconnaissance en tant que Grand Orient indépendant, ne donnent une suite à ses demandes. Le 26 juin 1786, il préside pour la dernière fois sa Grande Loge Provinciale et abandonne ses fonctions. Il n'y survit que quelques mois.
M.B.
GAMBETTA, Léon
(Cahors, 1838-1882) Les francs-maçons se sont toujours enorgueillis d'avoir compté parmi leurs adeptes le père fondateur de la Troisième République. En fait, l'appartenance de Gambetta à la maçonnerie avait plus le sens d'un hommage rendu à l'institution que d'un militantisme actif.
C'est sa retentissante plaidoirie au procès Baudin de 1868 qui a fait du jeune avocat le chef de file de l'opposition «irréconciliable» à l'Empire*. Le programme électoral qu'il défend en 1869 à Belleville reste le texte fondateur de la tradition radicale. C'est à ce moment-là qu'il est initié, en mai, à Marseille où il est candidat aux élections législatives (en même temps qu'à Belleville). Il semble n'être revenu en loge* que le 8 juillet 1875, lors de la fameuse initiation de Jules Ferry* et d'Émile Littré* à La Clémente Amitié*. Le discours qu'il prononce en cette circonstance révèle le rôle qu'il attribue à la maçonnerie. Il apprécie l'action de cette « société laborieuse progressive, libre et fraternelle», face aux « prétentions saris bornes de l'église », mais il ne juge pas utile de s'y investir personnellement: «. Ces réunions sont les nôtres, elles sont faites par nous, mais nous sommes constamment retenus au-dehors. C'est ce qui nous empêche d'etre ici chaque fois que nous désirons vous rencontrer. » Membre du gouvernement de la Défense nationale formé le 4 septembre 1870, il s'oppose à ses collègues demeurés à Paris quand ils accepter~t de signer l'armistice. Son bellicisme contribue à faire perdre aux républicains les élections de février 1871.
Silencieux pendant la Commune*, Gambetta rentre en scène en juin 1871 et entaine l'évolution qui va en faire l'un des symboles de 1'« opportunisme ». Il s'emploie à donner du parti républicain l'image d'un parti de gouvernement, ennemi des utopies et des chimères, qui s'interdit d'alarmer inutilement les iritérêts, pour mieux rallier la paysannerie et les « couches nouvelles » (les classes moyennes). « Commis voyageur de la démocratie », Il est le leader de l'opposition à l'Ordre moral de Mac Mahon. En 1875 il persuade ses amis d'accepter au moins provisoirement une constitution qui ne satisfait pas toutes leurs aspirations, mais qui a le mérite de consacrer l'établissement de la République. Pendant la crise du 16 mai 1877, c'est un parti républicain uni derrière Gambetta qui affronte le « gouvernement des curés ».
Après la victoire républicaine, Gambetta est écarté des ministères par l'inimitié du chef de l'état, Jules Grévy. Relégué à la présidence de la Chambre, il exerce une magistrature d'influence. Son « opportunisme » le fait accuser par l'extrême-gauche radicale d'avoir renié le programme de Belleville. Il s'accommode en effet de l'existence d'un Sénat élu au suffrage restreint, et il ne pense pas qu'il soit possible d ,e séparer du jour au lendemain l'Église et l'état. Contre Clemenceau et ses amis, il soutient les premières manifestations d'impérialisme colonial de la Troisième République. Au lendemain des élections d'octobre 1881, Grévy l'invite enfin à former un gouvernement, le « Grand Ministère », mais celui-ci est renversé dès janvier 1882 par la conjonction de la droite, des radicaux et d'une partie des modérés. Gambetta meurt à la fin de la meme année.
S'il est clair que la maçonnerie a contribué au succès des campagnes de Gambetta contre l'Ordre moral, l'activité maçonnique du tribun a été extrêmement modeste .
G. B.
GANTS
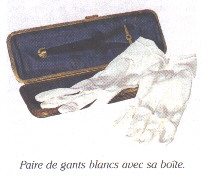 Toujours de couleur blanche à tous les rites* et aux trois grades* symboliques, les gants sont un des éléments indispensables des décors individuels de chaque maçon Au Moyen Âge, les tailleurs et les poseurs de pierre comme les morteliers portent des gants dans un souci de protection. À la même époque le gant est associé à la noblesse* et à la chevalerie. Il est également présent parmi les vêtements liturgiques du haut clergé romain.
Toujours de couleur blanche à tous les rites* et aux trois grades* symboliques, les gants sont un des éléments indispensables des décors individuels de chaque maçon Au Moyen Âge, les tailleurs et les poseurs de pierre comme les morteliers portent des gants dans un souci de protection. À la même époque le gant est associé à la noblesse* et à la chevalerie. Il est également présent parmi les vêtements liturgiques du haut clergé romain.
On voit que les bonnes raisons ne manquent pas pour justifier le port des gants d ans la franc-maçonnerie spéculative . Les gants sont aussi un attribut vestimentaire de la sociabilité élitaire dans laquelle se développe la franc-maçonne rie moderne.
Aux siècles suivants, on cherchera d'autres motifs pour expliquer l'usage des gants en loge*. Les gants blancs symbolisent la pureté du coeur et des moeurs et l'egalité entre les maçons. Ils sont également un emblème d' investiture, de mission et de droiture. Jules Boucher n'hésite pas à écrire: « On sait, de façon certaine, qu'un magnétisme réel émane de l'extrémité des doigts et les mains gantées de blanc ne peuvent laisser filtrer qu'un magnétisme transformé et bénéfique. »
Des rituels précisent, de manière parfois contradictoire, dans quelles circonstances il est convenable d' ôter les gants en tenue*, par exemple lors d'une chaîne d'union*.
 Dans certains rites ou ateliers on offre au nouvel apprenti* une deuxième paire de gants pour la femme (la personne) qu'il estime le plus. Cet usage est déjà signalé au XVIIIe siècle. Il semble succéder à une pratique plus ancienne selon laquelle c'est 1e néophyte qui offrait des gants au maître* de la loge, voire à tous les membres de l'association. A part son aspect utilitaire, le sens de cet usage parait en partie perdu.
Dans certains rites ou ateliers on offre au nouvel apprenti* une deuxième paire de gants pour la femme (la personne) qu'il estime le plus. Cet usage est déjà signalé au XVIIIe siècle. Il semble succéder à une pratique plus ancienne selon laquelle c'est 1e néophyte qui offrait des gants au maître* de la loge, voire à tous les membres de l'association. A part son aspect utilitaire, le sens de cet usage parait en partie perdu.
La remise d'une paire de gants à la « clandestine », la femme jugée la plus digne, doit rappeler au néophyte le souvenir de ses engagements, la dame étant censée être sa conscience et la gardienne de son honneur en cas de défaillance. Oswald Wirth* rapporte que Goethe initié le 23 juin0 dans la loge Amalia zu den dreien, sise à Weimar, offrit la seconde paire de gants à Charlotte von Stein, en lui faisant remarquer que si l'hommage était de peu de prix il présentait la caractéristique rare et précieuse de ne pouvoir être réalisé qu'une seule fois par un maçon La dame fut pour Johann Wolfgang a la fois une égérie, une maîtresse, une muse et un mentor. Bien que la rencontrant presque chaque jour, il lui écrivit -comme Diderot à Sophie Volland - 1700 lettres et billets qui furent plus tard publiés.
Notons enfin que dans certains grades supérieurs, notamment de l'écossisme, les gants sont noirs, quelquefois, pour le Maître Secret* (4°) rouges pour le Prince de Jérusalem (16°) jaune pour le Noachite (21°), ou blanche doublée et bordée de rouge pour le Grand Commandeur du Temple (27°).
Y. H.M.
GARIBALDI, Giuseppe
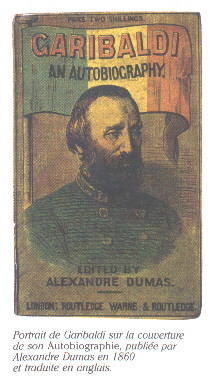 (Nice, 1807-Caprera, 1882) Deuxième fils de Domenico et de Rosa Raimondi, Garibaldi étudie en cours privés l'histoire, l'italien, l'anglais et le latin. De 1824 à 1833, il poursuit une carrière dans la marine marchande et devient capitaine. En 1832, il commence à s' intéresser aux événements politiques italiens. Il découvre la pensée des saint-simoniens et, à la fin de 1833, à Marseille, il entre en rapport avec Mazzinii qui l'implique dans les préparatifs du mouvement contre le royaume sarde. Après l'échec de l'insurrection génoise en 1834 Garibaldi est obligé de fuir à Marseille, puis en Amérique du Sud. De 1837 à 1841, il reste au service du Rio Grande del Sul: il est corsaire et il participe à la campagne dans l'état de Santa Caterina. C'est là qu'il rencontre Anita, qu'il épouse à Montevideo et qui lui donne trois enfants. De 1841 à 1848 il commande les expéditions sur le Parana et l'Uruguay. Il combat pour défendre Montevideo. En ]843, il fonde la Légion italienne. Son nom et ses exploits deviennent célèbres en Europe grâce aux journaux de Mazzini.
(Nice, 1807-Caprera, 1882) Deuxième fils de Domenico et de Rosa Raimondi, Garibaldi étudie en cours privés l'histoire, l'italien, l'anglais et le latin. De 1824 à 1833, il poursuit une carrière dans la marine marchande et devient capitaine. En 1832, il commence à s' intéresser aux événements politiques italiens. Il découvre la pensée des saint-simoniens et, à la fin de 1833, à Marseille, il entre en rapport avec Mazzinii qui l'implique dans les préparatifs du mouvement contre le royaume sarde. Après l'échec de l'insurrection génoise en 1834 Garibaldi est obligé de fuir à Marseille, puis en Amérique du Sud. De 1837 à 1841, il reste au service du Rio Grande del Sul: il est corsaire et il participe à la campagne dans l'état de Santa Caterina. C'est là qu'il rencontre Anita, qu'il épouse à Montevideo et qui lui donne trois enfants. De 1841 à 1848 il commande les expéditions sur le Parana et l'Uruguay. Il combat pour défendre Montevideo. En ]843, il fonde la Légion italienne. Son nom et ses exploits deviennent célèbres en Europe grâce aux journaux de Mazzini.
En 1844, Garibaldi est initié à la maçonnerie dans la loge L'Asil de la Vertud de Montevideo, une loge irrégulière. Il obtient toutefois sa régularisation la meme année, auprès de la loge Les Amis de la Patrie.
En 1848, dès qu'il apprend que la guerre a éclaté en Italie il s'embarque avec ses hommes pour venir combattre pour l'indépendance. Le roi de Sardaigne Carlo Alberto refuse l'aide de ce guérillero condamné par ses tribunaux. En revanche le gouvernement provisoire de Lombardie accepte son aide. Les bouleversements de Rome, la fuite du pape à Gaeta et la proclamation de la République romaine, le 9 février 1849, le convainquent de rejoindre la ville. C'est là, durant le long assaut contre l'armée française, que Garibaldi consolide le mythe qui allait l'accompagner toute sa vie. Avec ses volontaires vêtus d'une chemise rouge, il écrit des pages de gloire. Le 3 juillet 1&49, la République tombe et Garibaldi échappe à la capture par une longue fuite à pied vers le nord, au cours de laquelle Anita meurt. A la fin des événements de la première guerre d'indépendance, il quitte à nouveau l'ltalie pour les États-Unis et reprend son activité de marin dans le Pacifique. Il rentre en Italie en 1853: il se détache de Mazzini en adoptant des positions philo-piémontaises, convaincu que pour battre l'Autriche il faut une armée bien organisée et une diplomatie. Il adhère en 1857 à la Société nationale. une association de démocrates disposés à renoncer aux aides républicaines pour obtenir l'aide du royaume de Sardaigne indispensable pour réussir l'unité de la Péninsule.
En 1859, la seconde guerre d'indépendance ayant éclaté grâce à l'alliance entre Cavour et Napoléon III, Garibaldi obtient le commandement des forces volontaires réunies dans le Corps des Chasseurs des Alpes. L'année suivante, il commanda l' expédition des Mille qui, partie de Ligurie, débarque en Sicile et conquiert tout le sud de l'ltalie. Garibaldi. très connu dans le monde entier, a pu compter sur l'appui économique et diplomatique de l'Angleterre (où il fera un voyage triomphal en 1864). À Palerme, en juin 1860, il est élevé au grade de maître* maçon. Pendant l'entreprise garibaldienne, il y a une large floraison de loges dans toute la péninsule, les ateliers devenant un lieu de médiation entre les courants politiques libéraux modérés et les courants plus démocratiques. En 1861, Cavour refusant d'inclure dans l'armée italienne tous les volontaires qui ont combattu avec Garibaldi, celui-ci rompt ses rapports avec le gouvernement. Lors de la Première Constituante Maçonnique Italienne qui se réunit à Turin à la fin de cette année-la, Garibaldi est acclamé Premier franc-maçon italien. En 1862 le Conseil Suprême de Palerme l'élève au 33° et c'est avec l'aide des loges de cette obédience que Garibaldi organise fin juin 1862, l'expédition vers Rome pour libérer cette ville du pape. La même année, Il est arrêté à Aspromonte et fait prisonnier. Par le débarquement en Sicile, il montre clairement qu'il veut conférer à la maçonnerie u n rôle central dans l'action pOlitico militaire pour la libération de Rome.
A cette occasion, il fait 1( initier " tout son état-major. L'échec de son initiative déplace l'hégémonie maçonnique au nord, à Turin, où l'on proclame que l'Ordre est en dehors des luttes politico parlementaires. En mai 1864, à Florence, Garibaldi est élu Grand Maître du Grand Orient d'ltalie avec Francesco De Luca à ses côtés. Quelques mois plus tard, il donne sa démission, en se voyant dans l'impossibilité de garder unies les trop nombreuses âmes de la démocratie italienne et à cause de l'hostilité avec laquelle l'obédience palermitaine avait accueilli son élection par la Constituante florentine. En 1866, durant la troisième guerre d'indépendance, il a également commandé un corps de volontaires, auxquels on doit les seules victoires de cette guerre, puis, en 1867, après avoir conquis Monterotondo, pour aller à Rome il combat les Français à Mentana où il connaît un douloureux échec. En 1867, Garibaldi accepte aussi la charge de Grand Maître honoraire à vie du Grand Orient d'ltalie. Lincoln lui offre un poste de commandement lors de la guerre de Sécession. Oublieux des torts subis, en 1870, Garibaldi vieux et malade, accourt à la défense de la Troisième République, dans la guerre contre la Prusse, à la tête de l'armée des Vosges qui se bat à Autun et à Dijon. En 1881, il épouse Francesca Armosino qui lui avait donné deux enfants. Il meurt et est enterré dans l'île de Caprera.
Sa réputation de héros romantique, cosmopolite, anti-tyrannique a été exaltée par Victor Hugo, George Sand, W. Scott, Dumas, G. Carducci* et E. Salgari. Aucune autre figure du XIXe siècle n'a marqué avec autant de force, par ses traits populaires, l'imaginaire du romantisme tardif. Connu également comme guérillero, le personnage de Garibaldi présente une réalité complexe et le rôle qu'il a Joué dans l'histoire de la démocratie italienne et européenne est loin d'être secondaire. Garibaldi et ses Chemises rouges restent le symbole des guerres justes, menées au nom du respect de la liberté des peuples contre les dictatures et les États absolus. C'est dans un contexte où la sociabilité des loges participe activement aux événements et est utilisée à des fins politiques que son parcours maçonnique doit être resitué.
A.M.I.
GARNIER, Pierre-Dominique
(Marseille, 1756-Nantes, 1827) Le général Garnier est le fondateur de la loge* Les Vrais Amis Réunis, l'un des ateliers dont l'histoire représente les mutations de la sociabilité maçonnique sous le Directoire et le Consulat.
Engagé à 17 ans dans le régiment d'infanterie de Beauce, il est signalé, après son retour de la Guadeloupe où il a appartenu à un corps de dragons (1784-1788), comme architecte dans sa ville natale. Il se montre très vite attaché aux principes de la Révolution française* et milite dans la garde nationale de Marseille. Il dirige le 21e bataillon de fédérés lors de la prise des Tuileries, le 10 août 1792. Le 15 septembre suivant, ce «héros » de la chute de la royauté est nommé à l'état-major de l'armée des Alpes. En septembre 1793 Garnier participe au siège de Toulon. Nommé général de brigade, il est envoyé dans le tout nouveau département des Alpes-Maritimes. Payeur général de l'armée des Alpes, il distribue des secours aux indigents du département qui reçoivent environ 35 000 livres (28 avril 1794).Il tente aussi d'éradiquer le phénomène contre révolutionnaire qui frappe cette région frontière: les Barbets. Il organise une colonne mobile, instrument efficace de la contre-guérilla rurale. À partir du mois d'août 1795, il est intégré à l'armée d'ltalie et participe à la plupart des campagnes militaires de l'épopée italienne.
Le contexte devient alors favorable à l'éclosion du premier atelier maçonnique à Nice et Garnier fonde Les Vrais Amis Réunis. Le département est en effet pacifié dans son ensemble et le roi de Sardaigne a abandonné ses droits sur l'ancien conté de Nice (traité de Paris, 15 mai 1796). La naissance de cette loge a sans doute lieu au cours de l'automne 1796. Garnier aurait été initié lors de son séjour à la Guadeloupe, sa loge mère* étant certainement Les Vrais Soutiens de la Guadeloupe, constituée par le Grand Orient en 1786. Vénérable* des Vrais Amis Réunis il trouve de nouvelles recrues parmi les milliers de fonctionnaires et de militaires d'outre-Var qui stationnent à Nice.
A partir de juillet 1798, ce général républicain est accaparé par le commandement des départements des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes. Son rôle est très contesté par ses adversaires qui l'accusent de prévarication, car il a acquis quelques biens nationaux. Il se rend en Italie durant la campagne de l'an Vll marquée par le reflux d es armées françaises. Commandant d'armes à Rome, il doit capituler le 30 septembre 1799. Poursuivis par les Austro-Russes il défend le Var en mai 1800. Suspecté alors par le Premier Consul pour ses opinions anticléricales et jacobines, il est réformé en 1801. I1 va pouvoir, à l'image de Gastaud*, se consacrer au rayonnement des Vrais Amis Réunis régularisés le 10 novembre 1801 en son absence. Très Sage du chapitre de Rose-Croix* souché sur l'atelier, il anime l'activité maçonnique niçoise et multiplie les initiations*, puisque la loge des Vrais Amis Réunis a largement dépassé le nombre de 100 affiliés en 1802. Rappelé en activité militaire en 1809, il commande les troupes impériales en Illyrie.
Il figure aussi au conseil municipal de Nice et il dispose de 6 000 francs de revenus annuels. Admis à la retraite sous la Restauration, il est élevé au rang de baron et de commandeur de la Légion d'honneur par Louis XVIII (janvier 1815). Sa fidélité aux idéaux de la Révolution n'est pourtant pas entamée puisqu'il prête ses services à Napoléon au cours des Cent-Jours. C'est dans un contexte de semi-exil qu'il finit ses jours à Nantes, mais l'honneur est posthume. Son patronyme est gravé sur l'Arc de triomphe de l'étoile.
M.I
GARNIER-PAGÈS, Étienne
(Marseille 1801-Paris, 1841) Le premier des deux frères, Étienne Joseph Louis, commis de commerce puis avocat à Paris, est entré fort jeune en maçonnerie. Selon La Revue maçonnique (juillet 1836), il appartient en 1826 à une loge* « irrégulière », vraisemblablement dépendant du Suprême Conseil de France. En 1827, il est vénérable de la loge Saint-Louis de France qui avait été, selon Bésuchet, compromise dans la Charbonnerie*. Il entre, la même an née , dans la prestigieuse loge des Neuf Soeurs*. Dirigée par l'avocat Delagrange, elle ne compte plus qu'une vingtaine de membres. Il a déjà amorcé une avancée dans les hauts grades* puisqu'il se présente comme chevalier Kadosh*. Les deux loges fusionnent en octobre 1827, ne consentant que le titre distinctif des Neuf Soeurs. Le nouvel atelier, en 1828, sous le maillet du banquier Richard de La Hautière, propose une réforme des statuts du Grand Orient*
Étienne Garnier-Pagès le remplace l'année suivante. Il est déjà connu comme républicain et participe aux activités de la société « Aide-toi, le ciel t'aidera » qui combat les Bourbons. Sur le tableau, on relève la présence. comme orateur, de Debains, un ardent républicain.
L'atelier, sous sa direction, étudie les fondements de la morale définie comme « M règle des rapports qui existent entre les hommes». Issue de la nature même de l'homme, « elle est donc indépendante des religions qui changent suivant les lieux et les temps ». La loge considère que la maçonnerie doit rester, indifférente aux opinions religieuses et métaphysiques qu'ils ont adoptées, et ne leur en fait jamais un titre d' exclusives»,. Une conclusion audacieuse, dans la continuité de celle des Amis de la Vérité* et qui précède les recherches conduites par Massol* dans La Morale indépendante. L'atelier se met en sommeil en 1831.
Étienne Garnier-Pagès ne figure pas sur la liste, au réveil en 1836. Il est devenu après les Trois Glorieuses, l'un des chefs du parti républicain et il préconise le suffrage universel. Député de l'Isère puis de la Sarthe de 1831 à 1835, il disparaît précocement en 1841, et son frère Louis tirera profit de son prestige.
GARNIER-PAGÈS, Louis
(Marseille 1803-Paris, 1878) Louis Garnier-Pagès a vraisemblablement été initié aux Amis de la Vérité*; il est signalé comme maçon en 1843 par La Revue rnaçonnique de Lyon et du Midi. Il n'apparaît cependant sur la scène maçonnique qu'en février 1848 quand, membre du gouvernement provisoire de la Deuxième République, il reçoit, revêtu de son cordon, ainsi que Marrast et Crémieux, la délégation du Grand Orient* venue féliciter le gouvernement. Il aurait, selon la même revue travaillé à l'union des obédiences* Nous n'avons trouvé la trace de sa présence en loge qu'en 1870, à Boulogne, au Réveil Maçonnique. Il assiste alors à l'initiation d'Allain-Targé et, en 1875, à La Clémente Amitié*, il guide les pas de Jules Ferry*. Député républicain sous le Second Empire*, il est à nouveau membre du gouvernement provisoire en 1870. Son gendre, Marie-Amaury Dréo (1829-1882), secrétaire du gouvernement de la Défense nationale en 1870 puis député du Var. est initié en 1864 à Isis-Montyon. Il a également été, en 1869 et en 1882, vénérable de L'école Mutuelle.
A. C.
GASTAUD, André
(Nice, 1755-1821) La trajectoire maçonnique de Gastaud montre comment, à partir du Directoire les loges*, comme Les Vrais Amis Réunis*, purent servir de réceptacle à des anciens jacobins pour qui l'adhésion à la franc-maçonnerie entrait dans des stratégies fort différentes. Certains, comme Gastaud, étaient soucieux de faire oublier un passé compromettant et, en pays niçois, de faire jouer un rôle à la maçonnerie dans la mise en place des processus d'intégration à la nation française.
Marié le 28 août 1773 à la fille d'un négociant d'Antibes, Gastaud représente l'archétype du représentant de la petite bourgeoisie niçoise rallié aux principes de la Révolution*. Simple fils de vermicellier victime de deux faillites dans ses affaires commerciales, il a cessé d'être négociant en 1790. Membre de la Société populaire de Nice dès sa fondation en octobre 1792 il fait sa première expérience politique. Il appartient à la Convention nationale des colons marseillais et espère devenir le représentant du nouveau département des Alpes-Maritimes qui est organisé en février 1793. En avril, il participe à l'administration départementale et appartient au comité de surveillance jusqu'à la fin de brumaire an III. Dirigeant jacobin niçois, Gastaud est l'interprète de l'orthodoxie robespierriste et victime de la réaction thermidorienne de ventôse an III menée par le représentant Beffroy. Incarcéré à Nice avec d'autres patriotes, comme Tiranty* il est transféré à la prison d'Antibes. Libéré quelques mois plus tard, Gastaud est désigné par Barras pour diriger le département des Alpes-Maritimes (28 décembre 1795). Sa fonction de commissaire du directoire exécutif départemental le met alors dans une position favorable pour acquérir des biens nationaux. Bien qu'abonné au journal de Babeuf, Le Tribun du peuple, il dénonce la conspiration et défend l'idée du rassemblement des modérés. Devenu champion du juste milieu, il rejoint la franc-maçonnerie au moment de l'apparition de la première loge autochtone à Nice, au cours de l'automne 1796
Les Vrais Amis Réunis « remplacent » er quelque sorte la société populaire qui s'est dissoute le 1er mai 1795, et la loge maçonnique est composée de nombreux anciens cadres jacobins. Si les autochtones francophiles, comme Gastaud ou Tiranty, sont minoritaires, ils composent l'élément stable de l'atelier qui n'est pas un nouveau club politique. Durant l'an V, devenu commissaire, Gastaud est préoccupé par l'ampleur prise, dans le haut pays, par les activités contre-révolutionnaires animées par les Barbets, dont les rangs se sont grossis de nombreux déserteurs et de conscrits réfractaires. Alerté par les rapports municipaux, il considère son département comme une nouvelle Vendée. Élu au Conseil des Anciens (10 avril 1798), Castaud perd son poste de commissaire. Il se brouille avec son ancien ami Joseph Dabray (1752-1831), membre des Cinq-Cents qui avait pu bénéficier comme lui de la grande « braderie » des biens nationaux. La rancune de Dabray sera tenace et, après le 18 Brumaire c'est lui qui intervient auprès du ministre de l'lntérieur Lucien Bonaparte pour que Gastaud n'obtienne pas la préfecture du département des Alpes-Maritimes. Le 12 mars 1800, c'est l'ancien oratorien Florens qui est installé. Gastaud peut participer davantage aux travaux de son atelier.
En ventôse an X, il est membre de la commission chargée de préparer le nouveau règlement intérieur des Vrais Amis Réunis. Sa loge est alors suspectée de politisation et de ne pas se rallier au Consulat. Le nouveau règlement insiste sur la motivation principale de la société maçonnique: « s'éclairer mutuellement sur les vrais principes de la morale et de la vertu... », et non s'occuper de questions politiques. Inscrit sur la liste des notables du département Gastaud propose sans succès sa candidature au conseil général en 1803. Paradoxalement, l'ancien président de la Société populaire niçoise reçoit la croix de Saint-Louis avant de mourir retiré sur ses terres, en 1821. Patriote francophile, l'ancien député aux Anciens a trouvé dans l'Ordre une « foi » éloignée des dogmes de la religion catholique. Il a contribué à mettre en pLace un modèle administratif efficient et fut un authentique républicain.
M.I.
GENÈVE
 L'histoire politique et maçonnique indépendante de Genève prend fin le 12 septembre 1814 lorsque la ville adhère à la Confédération helvétique.
L'histoire politique et maçonnique indépendante de Genève prend fin le 12 septembre 1814 lorsque la ville adhère à la Confédération helvétique.
La première mention de la franc-maçonnerie à Genève remonte à mars 1736. Ayant appris qu'une « Société de Massons libres » s'y est établie et qu'un certain Hamilton* en est « le Chef ». Les autorités genevoises le convoquent et lui interdisent de recevoir aucun citoyen de la ville. Installé Grand Maître de la Grande Loge d'Angleterre le 28 avril 1737, Darnley nomme Hamilton Grand Maître Provincial de Genève alors que ce dernier n'a plus d'activité maçonnique.
Les procès-verbaux des enquêtes sur la franc-maçonnerie, entamées par les autorités genevoises en 1744, recensent l'existence d'une demi-douzaine de loges, dont l'une se réunit dans la maison de Jeanne-Marie Bourdillon. La loge de son cousin, Léonard Bourdillon, établie en 1749 donnera lieu à une légende selon laque]le cette loge aurait été à l'origine de la fondation du Grand Chapitre illuminé de Stockholm (Eckleff*). Pendant la vingtaine d'années suivante, aucun document ne témoigne de l'activité des loges de Genève.
La récente analyse d'un manuscrit inédit, le «Livre de Registres n° 2 Pour la Grande Suprême Mère Loge St Jean de Genève », a permis d'établir que cette Grande Loge avait été créée en 1769 et ses premiers officiers, installés le 26 juin. Il contient les versions successives de ses règlements, les procès-verbaux du 16 février 1773 au 19 décembre 1778, et les listes des Grands Officiers élus chaque année, de 1769 à 1778. La Grande Loge de Genève n'a pas été créée par la première Grande Loge d'Angleterre et n'a jamais dépendu d'elle Quant à L'union des Coeurs, loge célèbre pour le rôle qu'elle joue au XIXe siècle au sein du Régime Rectifié*, elle est sans doute créée le 24 juin 1769 par la Grande Loge de Genève, et non pas le 7 février 1768, comme elle l'affirme encore aujourd'hui (Voullaire*).
La Triple Équerre d'Annecy, formée en 1767, l'avait rejointe le 9 juin 1771 et quittée peu de temps après. 16 « loges confédérées » dont 14 situées à Genève, font partie de cette Grande Loge en janvier 1773. À Genève même au cours des six années suivantes, elle crée 7 loges nouvelles, voit le retour de 4 loges qui l'avaient quittée et le départ de 15 autres, dont 10 seront définitifs. Des Genevois créent deux loges à l'étranger, Saint-Jean du Levant ou Orientale de Pera à Constantinople et La Discrétion le 13 août 1771 à Zurich, qui reçoit une patente de la Grande Loge de Genève le 20 avril 1772, adhère en septembre suivant à la Stricte Observance* sous l'influence de Lavater*, mais ne quitte officiellement l'obédience genevoise qu'en février 1776. Les règlements permettent d'appartenir simultanément à une loge confédérée et à une loge qui ne l'est pas. Comme l'indique une lettre écrite par le Grand Secrétaire de la Grande Loge en décembre 1774, presque tous ses officiers et ses Grands Maîtres possèdent des grades additionnels. Le premier chapitre de Rose-Croix* genevois, créé à la fin de 1770 par des frères reçus à Édimbourg*, Londres et Berlin, était probablement souché sur la loge La Prudence, l'une des plus anciennes loges de Genève.
De même que les cercles sont interdits par les autorités à la suite des insurrections la franc-maçonnerie genevoise interrompt ses travaux en 1782 et les reprend en 1786 en se morcellant. Des maçons tentent de réveiller l'ancienne Grande Loge. Cinq anciennes loges et deux ou trois loges nouvelles créent dans la clandestinité une nouvelle obédience, le Grand Orient National de Genève. Une loge sauvage, La Vraie Concorde, fondée à Genève le 24 décembre 1783, reçoit des constitutions du Grand Orient de France* le 2 août 1787. Le Grand Orient National apparaît au grand jour en mars 1789. L'une de ses loges L'Union (et non L'union des Coeurs), initie e 5 août suivant le prince Edward d'Angleterre (il signera comme Grand Maître de la Grande Loge des Anciens* L'acte d'Union des deux Grandes Loges d'Angleterre le 1er décembre 1813). Le Grand Orient National voit trois de ses loges le quitter le 4 décembre 1790 pour constituer un second Grand Orient National ce qui amené le premier à adopter le nouveau titre de Grand Orient de Genève.
L'insurrection qui éclate le 27 décembre æ renverSe le gouvernement de la République indépendante de Genève. Les travaux maçonniques sont à nouveau Interrompus par cette période révolutionnaire au cours de laquelle sept maçons, membres des tribunaux révolutionnaires, prononcent des condamnations dont six à mort, à l'encontre d'au moins 58 maçons.
Après l'amnistie de 1794-1795, le Grand Orient de Genève reprend ses travaux le 22 janvier 1796. Annexée à la France par le traité de réunion du 26 avril 1798 Genève devient le chef-lieu du département du Léman. La Grande Loge de Genève se reconstitue peu après sous l'autorité de son dernier Grand Maître Jean-Louis Faton. Ses tentatives d'union avec le Grand Orient de Genève n'aboutissent pas et, dans le souci d'entretenir la confusion, ce dernier prend le nouveau titre de « Grande Loge de Genève, connue sous le nom de Grand Orient ». Son Grand Maître, Paul-Louis Rival, a pour Grand Secrétaire l'ancien secrétaire du premier tribunal révolutionnaire, George Louis Voullaire.
Rival est un maître orfèvre qui en 1773, à 19 ans, était le plus jeune vénérable de la Grande Loge de Genève. Élu en 1794 l'un des 9 administrateurs de Genève syndic en décembre 1797, il a signé à ce titre le traité de réunion de 1798. Face aux dissensions genevoises, il quitte en 1800 ses fonctions maçonniques. Voullaire son successeur depuis octobre, est l'artisan de la transformation du Grand Orient en Grande Loge Provinciale de Genève relevant du Grand Orient de France, accomplie le 27 décembre suivant. En mars 1801, 5 des 8 loges de la Grande Loge de Genève acceptent de se réunir à la Grande Loge Provinciale, mais s'en retirent deux mois plus tard après de douloureux incidents. Trois d'entre elles s'affilieront au Grand Orient de France avec lequel, depuis 17861787, toutes les obédiences genevoises, sans exception étaient en correspondance amicale. La Grande Loge Provinciale suspend ses travaux le 12 février 1810.
A. B.
GENTILY, Anne-Marie, née Pédenau
(1882-Paris, 1972) Secrétaire au contentieux avant la guerre de 1940, puis luge au tribunal pour enfants et première femme assesseur d'un juge, Anne-Marie Gentily fut l'une des figures de proue de la maçonnerie féminine des années d avant-guerre et d'après-guerre.
C'est en 1925 qu'elle a été initiée à la loge* d'adoption* La Nouvelle Jérusalem n° 373 bis, de la Grande Loge de France*.
Compagnonne en 1927, elle est élevée à la maîtrise la meme année.
Elle fonde la nouvelle loge d'adoption Minerve no 410 bis dont elle est la première vénérable* de 1931 à 1937, puis vénérable d'honneur.
C'est en loge d'adoption qu'elle rencontre son mari Maxime Gentily, qui est membre de la Grande Loge de France.
En 1936, sa carrière maçonnique prend de l'envergure: elle est élue à l'unanimité Première Présidente du secrétariat du Congrès annuel des loges d'adoption, qu'elle préside aussi l'année suivante.
De confession juive, l'année 1940 l'oblige à partir en zone libre avec son époux. La guerre terminée elle se consacre à reconstituer les loges d'adoption. À l'instar des frères de la Grande Loge de France, les soeurs du secrétariat général (Suzanne Galland et Anne Marie Gentily qui entourent Germain Rhéal) créent un comité de reconstruction dans lequel elle s'intègre.
Il s'agit alors de reconstruire le plus de loges possibles avec les soeurs restantes.
Seules quatre loges reprennent leurs activités: Le Libre Examen n° 1, La Nouvelle Jérusalem n° 2, Minerve n° 4 et Thébah n° 5. C'est encore aux cotés de Germain Rhéal et de Suzanne Galland qu'Anne Marie Gentily formule une demande officielle auprès du Grand Maître* de la Grande Loge de France Dumesnil de Gramont* en faveur de la réintégration des loges d'adoption dans leur sein.
Elles essuient alors un refus en raison de la propre requête parallèle des membres de la Grande Loge de France qui étaient en train de chercher à se faire reconnaître de la Grande Loge Unie d'Angleterre*. Sous l'égide d'Anne Marie Gentily les loges d'adoption se réunissent en Convent en 1946 puis, en 1947 sous le titre d'Union Maçonnique Féminine de France (U.M.F.F.).
Elle en devient la première Grande Maîtresse, puis elle est nommée Grande Maîtresse d'honneur ad vitam de l'obédience* en remerciement de son dévouement. Elle reçoit, en 1970, le 33° du Rite Écossais Ancien et Accepté*, devenant ainsi l'un des neuf premiers membres du Suprême Conseil Féminin de France de la Grande Loge Féminine de France* nouvellement créée, deux ans avant sa mort.
I. M.
GIRAUD, Sébastien
(Pignerol, 1730 ou 1735-Turin, 1803) Originaire des environs de Pignerol, docteur en médecine et en philosophie de l'université de Turin médecin consultant du roi de Sardaigne, fondateur de la Société Royale d'Agriculture de Turin en 1785, puis membre correspondant de l'Académie des Sciences de cette ville en 1801, Sébastien Giraud est un intermédiaire culturel et maçonnique majeur entre la France et le Piémont, et avec toute l'ltalie*. Il est la clef de voûte septentrionale-complétée à l'autre extrémité de la Péninsule par les frères du Collège des Chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte de Naples-du dispositif mis en place par Willermoz* pour assurer la promotion de la « réforme de la réforme» templiére dans la péninsule italienne. De fait c'est sous l'impulsion de Sébastien Giraud, passé à la Stricte Observance* et devenu Grand Prieur d'ltalie, que le Grand Chapitre de Lombardie, implanté à Turin conformément à la géographie templière, se rallie à la réforme Lyonnaise des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte en 1779.
En Italie, deux collèges de Chevaliers Bienfaisants ont été créés à Turin et à Naples. Le premier réunit outre Giraud Gabriel comte de Berneze, nom d'Ordre a Turri aurea, Président du collège et Grand Maître Provincial de la 8e Province de la Stricte Observance - l'une des plus puissantes de l'ordre-, le marquis d'Albarey, capitaine au régiment de Piémont Cavalerie son parent le marquis de Caluse, et Ferdinand Scarampi de Courtemille, capitaine au régiment des Gardes infanterie. Tous les membres du collège de Turin ont été élevés à la Grande Profession et au grade de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte dans la capitale des Gaules, où est installé le collège Métropolitain de l'Ordre. Ils effectuent d'ailleurs de fréquents voyages à Lyon. L'envoyé des illuminaten* (très hostiles à la réforme de Willermoz) en Savoie et en Italie, Friedrich Munter, ne s'y est pas trompé. Il déclare:«Ici tout est Lyonnais ! »
Sébastien Giraud a su à merveille utiliser le carrefour stratégique du Piémont et les relations étroites entre Lyon* et Turin pour diriger vers la capitale des Gaules les francs-maçons étrangers séjournant en Italie susceptibles d'être convertis à la réforme Lyonnaise. Citons le baron Charles-Adolphe de Plessen, nom d'ordre a Tauro Rubro, chambellan et envoyé extraordinaire du roi de Danemark à Naples, qui allait devenir pour J.-B. Willermoz un informateur précieux en Allemagne* et en Scandinavie*. Recommandé par le frère a fabrone de Naples, puis par a serpente, alias Sébastien Giraud, de Turin, Plessen arrive à Lyon le 9 octobre 1779. A. Faivre peut donc écrire à juste titre que .. Giraud (a Serpente), médecin à Turin, Élu coën* et Grand Profès, est l'un des représentants les plus autorisés du willermozisme en Italie ".
Grand voyageur, Giraud entretient d'étroites relations avec les piliers strasbourgeois de la maçonnerie templière, notamment les banquiers luthériens Jean et Bernard Frédéric de Turckheim avec lesquels il échange une correspondance suivie et chaleureuse. Ce réseau «lotharingien » prend un relief tout particulier lorsqu'on constate qu'il épouse les principales routes du Grand Tour* qui mène les fils des bonnes familLes germaniques de Göttingen à Naples en passant par Strasbourg, Lyon et les régions transalpines. Sébastien Giraud, chancelier de Lombardie, était d'ailleurs bien décidé à défendre et à promouvoir les intérêts transalpins au sein d'une 8e Province Templière dominée par les dirigeants germaniques dont les abus de pouvoir et les décisions d'autorité dans la Péninsule blessaient profondément les frères italiens.
On connaît leurs démêlés avec Weiler et Wächter, auquel Giraud s'opposa violemment lorsque Wächter fonda des ateliers à Naples et à Padoue sans en référer aux frères italiens. Sébastien Giraud profita du Convent* des Gaules puis du Convent de Wilhelmsbad pour demander et obtenir avec le soutien de Willermoz, qui n'avait rien à lui refuser après le ralliement des Députés du Grand Chapitre de Lombardie à la réforme Lyonnaise, l'érection d'une nouvelle Province la 9e, puis 4e après l'adoption de la nouvelle matricule. Dans un discours remarqué, Giraud souligna avec force que l'organisation de l'espace maçonnique européen ne devait plus faire abstraction de la donne politique et territoriale profane. Les loges rectifiées du duché de Savoie ne pouvaient être durablement rattachées à la 2e Province d'Auvergne, dont Lyon était la capitale, sans risquer d'encourir les foudres des autorités «savoisiennes ». De même, les loges italiennes des États du roi de Sardaigne ne pouvaient plus dépendre de la direction allemande de la 8e Province. Toutes devaient être réunies dans une nouvelle Province, dont le ressort territorial épouserait les contours des États sardes.
D'une activité débordante, Sébastien Giraud devint également, à l'instar du maître Lyonnais, un chaud partisan du mesmérisme*, après avoir été invité par Willermoz à Lyon où Franz Anton Mesmer venait de fonder la Société de l'Harmonie. Il fut d'ailleurs à l'origine de l'implantation du mouvement mesmérien en Italie du Nord. L'invitation à participer au Convent des Philalèthes* de Paris apparaît comme une évidente reconnaissance de sa qualité de chercheur en « science maçonnique ", trop longtemps méconnue.
P.-Y. B.